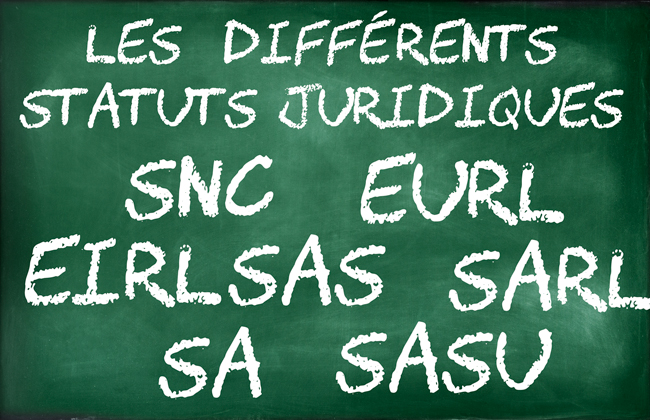Cession du droit au bail : définition, fonctionnement et formalités
Le locataire d’un local commercial peut transmettre son contrat de location à une autre personne, c’est ce que l’on appelle la cession du droit au bail. Le locataire qui transmet son contrat de location est appelé le cédant et le repreneur du contrat est nommé le cessionnaire.
Cette transmission peut avoir lieu lors de la vente du fonds de commerce ou ne concerner que la transmission du droit au bail seul.
Généralement, le contrat de bail précise les conditions de la cession (nécessité d’un acte notarié, de l’accord du bailleur, interdiction de cession, etc.).
Je vous explique les grands principes de la cession du droit au bail. C’est parti !
Cession du droit au bail : définition et fonctionnement
Vous le savez, toute location immobilière (à usage privé ou professionnel) nécessite la rédaction d’un contrat de location, également appelé un bail. Dans notre cas, on parle de bail commercial puisqu’il s’agit de la location d’un local professionnel.
Le locataire doit alors répondre à certaines obligations à l’égard du bailleur, à savoir :
- payer le loyer ;
- exercer l’activité autorisée par le contrat de location ;
- exécuter les conditions de la location prévues dans le contrat.
Lors de la cession d’un bail commercial, le locataire entrant (cessionnaire) achète le droit au bail au locataire sortant (cédant). Je reviens plus précisément sur le prix du droit au bail dans la suite de cet article.
Le cessionnaire reprend alors le contrat en cours (celui conclu entre le cédant et le bailleur), et ce pour la durée qui reste à courir. Autrement dit, la cession du droit au bail octroie au nouveau locataire la jouissance du local dans les mêmes conditions que le locataire précédent ainsi que le droit au renouvellement du bail commercial.
Droit au bail et fonds de commerce : la différence
Il me parait important de préciser deux notions souvent confondues : le droit au bail et le fonds de commerce.
Comme je vous l’expliquais, le droit au bail concerne donc la transmission du contrat de location entre deux personnes (morales ou physiques) : le locataire sortant et le locataire entrant. Le droit au bail ne concerne que la transmission du local professionnel.
En revanche, le fonds de commerce comporte tout ce qui permet à une entreprise de fonctionner : droit au bail, équipements, matériels, nom de marque, enseigne, clientèle, stocks, etc. Les contrats et les dettes sont également transmis lors de la cession d’un fonds de commerce. La valeur d’un fonds de commerce est donc plus élevée que celle du droit au bail.
À retenir : le droit au bail est automatiquement inclus dans le fonds de commerce. Le propriétaire du local professionnel ne peut pas s’opposer à la transmission, même si le contrat de location comporte une clause spécifique (article L145-16 du Code de commerce).
En ce qui concerne la cession du droit au bail seul, le propriétaire (bailleur) est en droit d’interdire la cession du droit de bail.
Cession du droit au bail : les interdictions
Si vous avez bien suivi, le propriétaire du local commercial ne peut pas s’opposer à la cession du droit au bail dans le cadre d’une vente de fonds de commerce.
Bon à savoir : le bailleur ne peut pas non plus interdire la cession du bail transmis dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’un apport partiel d’actif ou d’une transmission universelle de patrimoine.
En revanche, il peut s’opposer à la cession du droit au bail seul. Pour cela, le bailleur doit avoir inclus une clause dans le contrat de location du local commercial.
- La clause d’interdiction de cession du bail seul interdisant tout simplement toute cession de bail.
- La clause d’agrément impliquant l’obtention de l’accord du propriétaire avant toute cession de bail. Ainsi, le propriétaire est libre d’accepter ou non la personne proposée comme cessionnaire.
- La clause d’appel à concourir consistant à informer le propriétaire de l’identité du nouveau locataire, mais sans que son autorisation soit nécessaire. Dans une telle situation, le bailleur doit également être présent lors de la cession.
- La clause de garantie solidaire imposant au locataire cédant d’être solidairement lié au nouveau locataire pour le paiement des loyers et l’exécution du bail. En bref, si le nouveau locataire ne paie pas, alors le propriétaire peut se retourner contre le locataire précédent pendant une durée maximum de 3 ans après la cession du droit au bail.
Cession du droit au bail : les formalités à réaliser
La cession du droit au bail seul se déroule en plusieurs étapes. Je fais le point étape par étape !
1 - Vérifier s’il existe un droit de préemption à la cession du droit au bail
Lorsqu’un bail commercial est situé dans une zone spécifique (appelée périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité), la mairie peut exercer son droit de préemption commercial.
Cela signifie qu’elle a une priorité pour acquérir le droit au bail. C’est pourquoi il est indispensable de se renseigner auprès de la mairie avant d’effectuer la moindre démarche
2 - Rédiger le contrat de cession du bail commercial
Le contrat de cession du droit au bail peut prendre différentes formes. Il peut ainsi être rédigé avant d’être signé par les parties (on parle d’acte sous seing privé), être rédigé par un notaire (acte notarié) ou prendre la forme d’un avenant au contrat de bail commercial initial.
3 - Réaliser un état des lieux du local commercial
Un état des lieux doit impérativement être réalisé lors de la prise de possession du local par le cessionnaire. L’article L.145-40-1 du Code de commerce en définit les modalités, notamment que l’état des lieux doit être établi de façon amiable et contradictoire par le bailleur et le locataire entrant.
Toutefois, il est aussi possible de passer par un tiers mandaté (notaire ou agence immobilière, par exemple). L’état des lieux est alors à joindre au contrat de bail et à conserver par chacune des parties.
4 - Informer le propriétaire du local commercial
La cession du droit au bail doit être notifiée par le cédant ou le cessionnaire au propriétaire par acte de commissaire de justice, sauf si le bailleur a accepté la cession par acte authentique (acte notarié).
Bien évidemment, cette étape peut arriver plus tôt dans la procédure en fonction de la clause de cession éventuellement insérée dans le bail commercial.
Bon à savoir : il est aussi nécessaire d’informer les créanciers ou toute personne concernée.
5 - Publier une annonce légale de cession du droit au bail
Comme je le précisais juste au-dessus, il est obligatoire d’informer les créanciers et toute personne pouvant être impactée ou concernée par la cession du droit au bail (comme les concurrents, entre autres).
C’est pourquoi il faut publier une annonce légale de cession du droit au bail dans un support habilité dans le département où se situe le local commercial.
6 - Enregistrer et publier l’acte de cession du droit au bail
Enfin, il faut savoir que l’acte de cession du droit au bail doit être enregistré au service des impôts des entreprises (SIE) du lieu de situation du local commercial. Dans le cadre d’un acte notarié (ou acte authentique), c’est le notaire qui se charge de le faire enregistrer au service des impôts dont dépend son étude notariale.
Qu’importe la situation, le délai pour faire enregistrer l’acte de cession est d’un mois à partir de sa signature.
L’enregistrement de l’acte de cession entraîne des frais : les droits d’enregistrement. Ils sont en principe payés par le cessionnaire (repreneur). Toutefois, l’acte de cession peut prévoir qu’ils seront à la charge du cédant ou répartis entre les deux parties.
Les droits d’enregistrement sont calculés sur la base du prix de vente du droit au bail :
- 0 % si le prix de cession est inférieur à 23 000 € ;
- 3 % si le prix est compris entre 23 001 € à 200 000 € ;
- 5 % si le prix est supérieur à 200 000 €.
Sachant qu’un minimum de droit fixe de 25 € est systématiquement perçu.
Mais justement, comment définir le prix du droit au bail ?
Cession du droit au bail : le prix de vente
Généralement, le prix de cession du bail commercial repose sur la méthode de l’économie de loyer. Autrement dit, il faut calculer l’économie réalisée par le nouveau locataire en reprenant le bail commercial, c’est-à-dire la différence entre le montant du loyer et des charges initialement fixés et le prix du marché locatif pour un local commercial similaire.
Il convient ensuite d’appliquer au résultat obtenu un coefficient de commercialité pour prendre en compte la situation du local, sa visibilité et la densité de la population (éléments impactant la capacité du local à générer du chiffre d’affaires). Par exemple, pour un local situé dans une rue très commerçante et prisée où il est difficile de trouver un local commercial.
D’autres facteurs peuvent également entrer en ligne de compte, comme la clause de destination du bail qui peut jouer sur la valeur du bail. Un bail « tous commerces » aura ainsi plus de valeur qu’un bail avec une destination spécifique. Ce qui permettra, en plus, de mettre en concurrence les différents repreneurs potentiels.
Bon à savoir : la cession de bail peut aussi s’opérer à titre gratuit, même si c’est rarement le cas, le droit au bail constituant un actif (bien) du fonds de commerce.
Voilà, vous savez à présent tout ce qu’il y a à connaître sur la cession du droit au bail. Ce qu’il faut retenir ici est que la cession du droit au bail et la cession du fonds de commerce sont deux démarches différentes, bien que la cession du fonds de commerce implique la cession du droit au bail. Les formalités à réaliser ne sont donc pas tout à fait similaires.